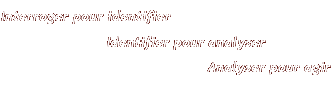Le Scooter n’est pas toujours source de « paix des ménages » chez les plus de 45 ans
Lors d’une récente étude nationale, portant sur les motivations et les freins de typologies masculines potentiellement attirées par la conduite de deux roues motorisés, on a pu mettre à jour plusieurs obstacles à la conduite, lesquels tendent à expliquer la composition du parc actuel, en termes de profils des possesseurs.
Par exemple, dans le cas des Hommes de plus de 45 ans, mariés et ayant des enfants, l’analyse approfondie des entretiens a permis de déterminer que la conjointe est le premier frein à l’achat d’un deux roues à moteur. En effet, les maris ont avoué, non sans réticence, que les arguments dramatisant la conduite et volontairement dissuasifs, de la part de leur conjointe, visaient à les mettre face à leurs responsabilités d’époux, de père, de gardien du foyer et ont donc eu pour effet de les inciter à différer leur décision d’achat « sine die ».
Cette tendance lourde s’est confirmée lors de l’analyse du contenu des entretiens réalisés auprès d’hommes appartenant aux mêmes tranches d’âges ou CSP, mais déclarant un état civil de célibataire, ou de membre d’un couple séparé, voire en instance de divorce. En effet, un grand nombre d’entre eux n’a pas hésité à préciser que le principal frein à la conduite du deux roues motorisé « n’existait plus » ou « n’existerait bientôt plus » dans la mesure où leur conjointe ne serait plus présente.
Ces attitudes sont validées par les comportements de ces « nouveaux célibataires ». En effet, nombre d’entre eux imaginent rajeunir leur propre image et reconquérir la compagne idéale au travers de la possession d’un deux roues motorisé. L’une des conditions implicites à leur entente étant que celle-ci soit également adepte du deux-roues motorisé.
Grâce à la convivialité et au confort des nouveaux concepts de Scooters, la puissance de ce frein psychologique régresse dans une large mesure sans attendre la conciliation…
Ce n’est pas la panne technique qui angoisse l’individu, c’est l’insécurité qu’elle génère
Récemment dans le cadre d’un baromètre de satisfaction réalisé auprès d’un échantillon d’automobilistes clients d’une importante compagnie d’Assistance, on a pu déceler une nouvelle attente d’assistance potentielle au travers des entretiens conduits avec des automobilistes de sexe féminin, en particulier.
En effet, le changement de roue lors d’une crevaison, hier certes plus fréquente, était banalisé par les automobilistes, dont une grande partie de femmes. Cet incident de parcours apparaît aujourd’hui beaucoup plus anxiogène, quoique relevant encore plus qu’avant de l’exceptionnel.
En fait, l’analyse du discours des intéressées démontre que ce n’est pas tant la crevaison qui est dramatisée que l’état d’insécurité régnant au niveau de l’environnement routier ou autoroutier lors de l’arrêt pour changer la roue défectueuse.
Au même titre que l’on est prêt à payer une prime visant au rapatriement de son véhicule lors d’incidents mécaniques, on se déclare prêt à payer une prime additionnelle dans la perspective de se voir dépanner sur route ou autoroute lors de crevaisons.
On observe d’ailleurs à ce propos que de plus en plus souvent ce n’est pas tant le risque technologique qui est source d’angoisse que le danger des conséquences physiques encourues et que dans ce registre, le prix psychologique ne constitue pas un frein à la signature de ces nouveaux contrats sécuritaires.
Les cadres appartenant aux groupes multinationnaux souhaitent lire utile
Lors d’un récent audit de lectorat international visant la perception du magazine de communication interne appartenant à un grand groupe multinational, par ses cadres expatriés et locaux, on a pu valider une attente explicite chez tous les lecteurs, et cela, quel que soit leur pays d’origine.
Il s’est confirmé que, plus les cadres occupent une fonction à vocation extravertie, ou appartiennent à un service opérationnel dans la filiale du pays considéré, et plus ces responsables attendent des informations adoptant un profil particulier concrètement exploitable localement.
On attend, en effet, la présentation de résultats faisant état de retours d’expériences ou d’opérations ayant trait à un même thème, émanant de pays plus ou moins limitrophes, dont le rédactionnel est traité de façon comparative inter-pays.
Selon les responsables interrogés, la lecture de ces informations circonstanciées leur permettra soit de s’en inspirer dans le cadre d’opérations similaires à initialiser dans leur pays d’adoption, soit de s’en distancier sciemment en raison, par exemple, de distorsions économiques ou structurelles existant entre le pays où s’est déroulée l’expérience réussie et le pays au sein duquel ils sont opérationnels.
En fait, les individus souhaitent relativiser et lire «utile», ils attendent des « benchmarking » inter-pays, qui leur permettent, lors du simple survol des articles de décider soit d’y consacrer quelques minutes additionnelles, soit de, rapidement, passer à la découverte d’articles suivants.
L’industrie agroalimentaire passera bientôt plus de temps à contrôler qu’à produire…
Une récente étude conduite dans l’univers des entreprises concevant et fabriquant des produits alimentaires types plats cuisinés, charcuterie salaisons, desserts lactés, voire même crèmes glacées a permis de conclure que bientôt, la mise sur le marché de denrées alimentaires ne sera réservée qu’à des grands groupes industriels, seuls susceptibles d’assumer les énormes investissements relatifs au respect de la législation européenne en matière sanitaire.
En effet, l’industriel se trouve aujourd’hui, assailli par les directives européennes imposant d’importantes démarches en matière de sécurité alimentaire, telles :
- Les études HACCP visant à identifier, puis à maîtriser les points critiques au niveau des process de fabrication dans une perspective de mise en œuvre de « bonnes pratiques »,
- La traçabilité par lots visant, en aval les produits finis et en amont les matières premières, ingrédients, additifs et autres auxiliaires,
- La prévention des crises sanitaires comprenant la recherche des OGM, allergènes, dioxine, listéria, et autre fièvre aphteuse…
- Enfin « cerise sur le gâteau » les référentiels et audits, conditionnant les référencements au stade de la grande distribution.
Comme l’énonçait l’un des représentants de ces industriels : « Demain on contrôlera les contrôles effectués sur les process-produits, sans nous apercevoir qu’on produira de la m…. aseptisée… ».
Conséquence ou retour des choses : On observe une nette simplification des recettes, ou un regain d’intérêt à l’égard d’assemblages basiques en matière culinaire !
Les motivations évoluent, la preuve : Nos jeunes veulent aller chez le dentiste !…
Lors d’entretiens concernant l’hygiène bucco-dentaire, réalisés auprès de jeunes adolescents, quel n’a pas été notre étonnement d’enregistrer les propos d’un certain nombre d’entre eux relatant leur souhait « de porter, comme leurs amis, des appareils visant à leur assurer des dents bien alignées »…
En fait, si rationnellement on peut simplement classer ce comportement en indiquant que les jeunes font partie de ce « nouveau tiers » des patients qui souhaitent consulter à titre préventif … on peut aussi analyser, au travers de leurs propos, que, plus impliqués que leurs aînés par les contacts relationnels, ils ont pris conscience du double rôle des dents dans la bouche : rôle à la fois fonctionnel et esthétique. Ces jeunes ont en réalité, consciemment ou non, anticipé la dimension sociale de leur sourire.
S’il y a 25 ou 30 ans on allait chez le dentiste parce que l’on avait très mal aux dents, en pensant que l’on aurait peut-être moins mal après …. Aujourd’hui un individu sur trois souhaite se rendre dans un cabinet dentaire pour prévenir la douleur et s’ouvrir de ses préoccupations concernant les améliorations esthétiques réalisables dans sa bouche.
On évalue statistiquement qu’un deuxième tiers se rend ponctuellement chez le dentiste uniquement pour se faire soigner et qu’enfin le dernier tiers évite toujours tout recours, sinon exceptionnel, au praticien qui demeure à ses yeux synonyme de douleur, voire de soins onéreux.
Il est intéressant d’observer que cette nouvelle génération de jeunes patients ne fait plus systématiquement référence à la douleur et focalise ses attentes sur la dimension esthétique permise par le traitement. Chez ces derniers, la motivation profonde a estompé le frein latent associé à la crainte de souffrir et a induit une modification notable du statut du dentiste :
Ce dernier devient le partenaire, l’embellisseur, celui par lequel on offrira à l’autre une image esthétique et un « look d’enfer » tant dans la vie privée que professionnelle.