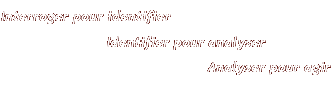Faire parler les chiffres quand ils ne disent rien : un risque évitable …
Lors d’une récente étude de satisfaction visant des services à la personne dans l’univers domestique, les résultats statistiques situés au sein des deux quartiles extrêmes d’une courbe gaussienne ont permis d’évaluer clairement les opinions des clients interrogés.
Il a donc été possible de concevoir des actions visant à répondre aux segments des « plus satisfaits » et à remédier aux « insatisfactions » les plus notoires. Toutefois, il convient d’observer que ces populations ne représentent, à elles deux, moins d’un tiers de l’échantillon interrogé.
Les résultats concernant les deux tiers restant, c’est à dire la majorité de l’échantillon se situant au sein de l’espace interquartiles sont plus complexes à interpréter dans la mesure où les taux de satisfaction ou d’insatisfaction sont moins discriminants, se situant autour de la médiane. Il s’agit ici de ce que l’on a coutume d’appeler la « majorité silencieuse ».
En l’état, la définition d’actions adaptées s’avère problématique pour ne pas dire impossible. L’approche quantitative a donc du être complétée par une analyse qualitative fondée sur la réalisation d’entretiens individuels.
Le contenu de ces entretiens a permis, d’une part de décrypter les raisons conduisant à ne pas émettre d’opinions tranchées et d’autre part à interpréter ces justifications en vue de revoir les prestations de services afin de les adapter aux attentes des clients.
Une fois encore on a pu vérifier la grande complémentarité des deux techniques d’analyse : En effet, les chiffres parlent d’eux mêmes, mais dans le cas où le score reste muet, il est très hasardeux de « le faire parler ».
Le syndrome de Nif-Nif plie mais ne rompt pas !
Lors d’une étude visant les énergies et les matériaux renouvelables dans l’habitat on a pu mettre à jour la permanence de stéréotypes qui ont la vie dure en matière de construction.
En effet, si l’on convient spontanément que le bois constitue une énergie s’inscrivant idéalement dans des utilisations durables, lorsqu’on l’envisage en tant que matériau de construction force est de constater que bon nombre d’idées reçues perdurent.
La grande majorité des individus lui attribuent d’énormes avantages sur le plan de l’isolation thermique, phonique voire de résilience en tant que composant de structure, toutefois dès qu’il s’agit de la construction en soi, on reste très attaché à la maison en maçonnerie.
Seul un petit nombre d’individus pourraient imaginer s’intéresser à la construction d’une maison en bois toutefois on observe qu’un grand nombre d’alibis psychologiques alimentent les objections émises par les interviewés : en synthèse, ceux qui habitent le sud de l’hexagone objectent que le bois est plus adapté au climat nordique et ceux qui habitent le nord choisiraient idéalement ce matériau s’ils habitaient la montagne, voire le sud ! En fait malgré les arguments rationnels, écologiques, techniques en faveur du bois on reste plus que jamais attaché à un investissement dans la pierre qui associe valeur objective et valeur affective, pérennité dans le temps, solidité et statut social….
En fait le conte pour enfants qui présentait 3 petits cochons risquant leur vie dans une maison construite en bois qui ne résistait pas au souffle du loup est encore inconsciemment présent lors du choix des matériaux de construction. Ces mêmes petits cochons n’avaient, en effet, la vie sauve que grâce à la solidité de murs construit en briques.
Si l’on souhaite modifier les images d’Épinal qui pénalisent encore ce matériau noble qui résiste aux séismes … ne conviendrait-il pas de faire appel à un conteur inspiré, plutôt qu’à un concepteur de publicité ….
Les nouvelles technologies de communication : « maux ou remèdes » de la vie quotidienne ?
En marge d’un test d’usages et habitudes visant un nouveau support de communication on a pu mettre à jour la prise de conscience générale à l’égard de la disparition de la frontière qui séparait, il y a encore quelques années, la vie privée de la vie professionnelle.
Hier, il existait un clivage correspondant à des principes historiques selon lesquels la vie privée devait rester en dehors de la vie professionnelle. Ces principes qui interdisaient les incursions d’une vie dans l’autre, sous peine de pénalités voire de sanctions autorisaient toutefois une vie équilibrée. Aujourd’hui Internet et l’ensemble des terminaux, ordinateurs personnels et téléphones portables modifient profondément le caractère binaire de la vie d’un individu quel que soit son profil.
Si ces nouvelles technologies favorisent le travail individuel ou solitaire qui se prolonge au domicile au delà des horaires professionnels, les outils de travail sont désormais utilisés indifféremment à des fins professionnelles et privées. Ils permettent d’une part de rompre l’isolement au travail et d’autre part de ne pas couper les ponts avec la vie professionnelle durant les périodes dédiées à la vie privée.
En pratique, il n’existe plus de frontière entre les deux univers : les supports ne servent plus tant à importer un peu de stress à la maison qu’à introduire un peu d’intimité au travail : appels téléphoniques, courriels, SMS privés ou professionnels, en direction des clients, fournisseurs, parents amis se succèdent durant les mêmes plages horaires.
Immergés dans une vie professionnelle omniprésente qui cannibalise leur quotidien, les individus ont trouvé dans ces nouvelles technologies à la fois la réponse à leur besoin psychologique d’appropriation d’instants de vie privée et le remède contre l’isolement professionnel.
Faire un geste pour la planète … pourquoi pas, mais lequel ? et qui en bénéficie ? …
Les études conduites dans le registre de l’écologie, des économies d’énergie ou du développement durable démontrent une prise de conscience grandissante que la planète, en tant que bien commun, requiert attentions et intentions de la part de ses occupants.
Cette bonne volonté trouve toutefois ses limites dans un égoïsme latent qui reprend vite le dessus et se traduit immanquablement par des questions relatives au gain ou à l’intérêt constituant une contre partie compensatrice pour le consommateur bien intentionné.
Si faire un geste pour la planète peut être envisagé, encore faut-il que dans un premier temps, une proposition existe et soit compréhensible, concrète enfin facilement réalisable par l’individu. Dans un deuxième temps, que le résultat de ce geste soit directement perceptible économiquement par l’éco-citoyen potentiel.
Le réalisme de ce compromis conditionnel « gagnant-gagnant » s’est vu confirmé lors d’une récente investigation, visant un dispositif permettant d’éviter le gaspillage d’énergie engendré par les appareils multimédias restant en veille.
Si l’adhésion unanime des consommateurs a été clairement mise à jour, c’est en grande partie parce que la dimension écologique se doublait d’une promesse économique sensibilisatrice mettant en avant les gains réalisables sur la facture individuelle d’électricité.
Les consommateurs, dans leur ensemble, ont plébiscité cette action dont ils ont perçu la complémentarité. Contrairement à ce qui se passe habituellement, dans la cause présente on ne s’est pas contenté pas de recommander l’accomplissement « d’un geste pour la planète », mais on a indiqué la nature du geste à accomplir et cerise sur le gâteau, on a promis au réalisateur du geste une contre partie directement visible à son niveau.
Cette action exemplaire devrait servir de modèle aux initiatives privées ou publiques qui trop souvent contribuent à l’ésotérisme de notions comme l’écologie ou le développement durable.
La pertinence d’une segmentation dépend du caractère discriminant de la variable retenue
Une mission visant à définir de nouvelles offres commerciales en adéquation avec les besoins des clients, a mis en lumière l’importance de la recherche de la variable la plus pertinente destinée à segmenter la population ciblée.
La segmentation de la clientèle qui préexistait dans l’entreprise tenait compte des caractéristiques objectives des produits fabriqués par les clients. Ce critère ne permettait pas de structurer le marché en segments homogènes et significatifs en raison de l’importante dispersion des profils des produits visés.
L’investigation réalisée a confirmé que l’application technique permise par les équipements industriels ne constituait pas une variable discriminante du fait, d’une part de son importante similarité chez tous les clients, et d’autre part de sa forte imbrication avec d’autres applications composant les très nombreuses étapes de la chaîne de fabrication au sein des entreprises.
Il convenait donc d’identifier une variable plus explicative permettant de découper le marché en segments représentatifs.
La réalisation d’entretiens auprès de décideurs chez les clients a permis d’atteindre cet objectif. En effet, confrontées à une concurrence intercontinentale engendrée par la mondialisation les entreprises ont été contraintes d’opter pour des positionnements produits différenciés.
Cette variable transversale au sein des différentes strates de clients, a permis d’opérer une segmentation d’autant plus signifiante que celle-ci valorise les bénéfices induits par les équipements industriels commercialisés par le fournisseur dans le nouveau contexte économique.
De nouvelles pistes d’offres technico-commerciales dédiées ont donc pu être définies en tenant compte de ce nouveau découpage permis par la mise à jour d’une variable qualitative discriminante.