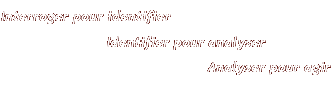Souhaiter réaliser des économies d’énergie implique souvent des investissements non négligeables
Lors d’un sondage portant sur la perception et les attitudes à l’égard des économies d’énergie, on a pu mesurer l’impact notable de l’appellation générique « basse consommation » des nouvelles ampoules, lors des achats de renouvellement. En effet, plus de 9 individus sur 10 ont déclaré avoir déjà acheté au moins une ampoule portant ce nom.
Si les acheteurs jugent crédibles les promesses relatives à l’économie d’énergie réalisable au moyen de cette nouvelle génération d’ampoules dont la durée de vie sera cinq fois supérieure à celle des ampoules actuelles, une majorité émet des critiques ciblées qui témoignent toutefois des progrès attendus :
Plus d’un consommateur sur deux attendrait des produits dont l’intensité lumineuse permettrait un éclairage moins blafard, plus contrasté, en un mot plus agréable pour l’œil.
Un nombre aussi important verrait d’un bon œil un allumage plus rapide, soulignant ici l’absence de réactivité des ampoules basse consommation lorsque l’on appuie sur le bouton.
Un petit nombre attendrait un choix d’ampoules plus varié de façon ce que la substitution à l’identique soit rendue possible.
Enfin les trois quart des individus s’élèvent contre les prix de ces produits, jugés très élevés comparativement au prix des ampoules à incandescence : On évoque des coefficients multiplicateurs allant de 5 à 10.
En fait lorsque l’on prend le temps d’écouter les consommateurs on observe que l’agressivité à l’égard du prix en relation avec les limites techniques des produits est d’autant plus manifeste que l’individu éprouve le sentiment d’être contraint à un achat captif sur un marché où la concurrence est encore inexistante.
Le focus group un outil incontournable dans le domaine de la production d’idées au service de la création …
Opter en faveur de la réalisation d’un focus groups réunissant 8 ou 9 participants, plutôt qu’à des entretiens individuels, dépend principalement de la nature des résultats attendus.
Les interactions entre les participants, suscitées et encouragées par le modérateur, engendrent une émulation collective et, par la même, une auto-stimulation qui génère le développement des réactions, la multiplication des réflexions et, in fine, le décuplement des idées au sein du groupe : les commentaires des uns favorisant des perceptions évolutives chez les autres, leur permettent ainsi de rebondir et de dégager de nouvelles idées.
C’est en fait cette caractéristique, à savoir la richesse de la production d’idées qui conditionne le choix méthodologique du focus group dans le cadre d’investigations à but constructif ou créatif.
Les focus groups sont particulièrement adaptés dans le contexte d’approches à vocation innovante, démarches visant à faire évoluer une application, à réactualiser un produit, à faire progresser un concept existant.
Cette modalité peut aussi, du fait de la diversité et du caractère souvent inattendu des informations recueillies, créer les conditions d’émergence, ou provoquer la découverte d’une nouvelle invention de la part de l’entreprise ayant commandité la mission.
Si ce mode de saisie collective des données constitue aussi l’outil idéal en vue de mettre à jour les applications potentielles issues d’innovations, d’inventions voire de découvertes nouvelles, on tiendra toutefois compte de ses limites techniques sur le plan de l’extrapolation des résultats.
En effet, il conviendra de s’assurer que les attitudes identifiées lors d’une réunion se confirment, d’une part lors de la tenue d’un second groupe de validation organisé dans des conditions similaires, et d’autre part, qu’il n’existe pas de rejet ou de distanciation lorsque l’individu se trouve hors l’influence du groupe, c’est à dire en posture solitaire, dégagé du contexte collectif.
Les économies d’énergies constituent une clé d’accès à l’écologie…
Les études que nous avons réalisées auprès du grand public, ayant eu pour cadre les grands thèmes que sont le développement durable, le respect de l’environnement ou le réchauffement de la planète ont permis de constater la lenteur des changements comportementaux à l’égard de ces causes d’intérêt général.
Si les médias tentent de sensibiliser le grand public à l’aide de messages impliquant voire alarmistes, les analyses concernant la perception de ces campagnes démontrent que celles-ci sont souvent vécues comme abstraites par le plus grand nombre, ou culpabilisantes selon ceux ayant su décrypter les messages mais n’ayant su les concrétiser à leur niveau en termes d’actions.
Plus récentes, les campagnes visant les mêmes objectifs mais les traitant sous l’angle des Économies d’Énergies interpellent les consommateurs. En effet, les préconisations incitant entre autres à s’affranchir d’une énergie fossile au profit d’une énergie renouvelable, en d’autres termes remplacer une chaudière au fuel par une pompe à chaleur, substituer une baignoire par une douche pour économiser l’eau, remplacer des ampoules à incandescence par des ampoules basse consommation, changer les huisseries de fenêtres et améliorer l’isolation pour optimiser la consommation d’énergies sont autant d’exemples concrets qui permettent aux individus de mieux percevoir où commencent les actions individuelles en faveur de la protection de la planète.
Les études d’attitudes mettent à jour que ces exemples ont un point commun : ils sous-entendent la réalisation d’économies au stade du particulier. Ayant misé sur la réponse à des motivations financières individuelles, ces campagnes atteignent leur objectif d’intérêt général, quand bien même celui-ci n’est pas dicté par un comportement « éco-citoyen ».
En conclusion, peu importe les moyens, seul le résultat compte, mais force est de constater, qu’ici encore, c’est un principe « gagnant-gagnant » qui permet de concilier les intérêts particuliers et collectifs.
La troisième roue lève de nombreux freins à l’achat d’un deux roues motorisé …
Lors d’un sondage réalisé auprès de possesseurs de deux roues utilisés en ville, on a pu mesurer l’évolution notable de l’image du scooter depuis l’avènement de la troisième roue, et cela plus particulièrement au sein des typologies d’individus de plus de 40 ans.
Aux yeux de cette population la troisième roue confère à l’engin une stabilité non seulement physique, mais psycho-sociologique. Ces derniers ne déclarent-ils pas, en effet, ne pas avoir eu de problème particulier pour faire admettre à leur entourage direct que grâce à cette « triangulation », il s’agit non plus d’un deux roues, traditionnellement associé à une adhérence précaire, mais d’un compromis maniable et équilibré situé a mi-chemin entre 2 et 4 roues.
Selon un bon nombre de possesseurs de ces nouveaux scooters, l’image du possesseur s’en trouve revalorisée. Il n’existe plus d’un coté « les vrais », possesseurs d’un permis A (moto), seuls autorisés à choisir la cylindrée de leur monture et « les autres », à savoir les possesseurs d’un permis B, ex-automobilistes, n’étant autorisés qu’à conduire des deux roues dont la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cc.
En effet, la possibilité de conduire un 250 cc voire un 400 cc, en n’étant détenteur que d’un permis B (auto) sonne le glas de la dichotomie frustrante qui existait dans le monde du deux roues.
Chaînon manquant, l’arrivée de cette famille comble le dernier vide existant entre les 2 et 4 roues dans le paysage urbain. Si les possesseurs d’un permis A ne semblent pas attirés par cette nouvelle configuration tri-cycles et resteront fidèles aux deux roues traditionnels, les automobilistes de plus de 40 ans plébiscitent cet hybride au carénage protecteur sécurisant qui dédramatise la conduite de ce qui ne comporte pas 4 roues et qui leur permettra de concilier mobilité urbaine et ponctualité aux rendez-vous.
L’image interne est aujourd’hui plus que jamais, une composante cruciale de l’image de marque de l’entreprise.
Lors de la réalisation récente d’un baromètre visant à mesurer le climat social d’une entreprise, les résultats ont permis d’identifier l’incidence croissante de la perception de l’image interne de l’entreprise par ses salariés sur son environnement et son développement.
Les notes exprimées à l’égard de l’ambiance au sein de l’entreprise et plus particulièrement les réponses aux questions ouvertes visant l’évolution de carrière permettent de constater qu’au delà de la préoccupation visant à anticiper des symptômes d’insatisfaction, ou à remédier aux dégradations du climat qui demeurent la priorité pour prévenir d’éventuels conflits sociaux, il s’avère que dans le contexte économique actuel la représentation qu’ont les salariés de leur entreprise prend une dimension inédite jusqu’alors.
Si en temps normal, les produits, les services et la communication externe permettent d’entretenir l’image de l’entreprise et d’assurer une cohésion vis à vis de l’extérieur, dans le contexte de défiance actuel on constate que l’état d’esprit et le moral des équipes en relation avec le monde externe, c’est à dire : les clients, prospects, prescripteurs, distributeurs, fournisseurs, recruteurs, candidats à l’embauche, doivent être l’objet d’attentions particulièrement soutenues dans le cadre de ces enquêtes.
Ces acteurs étant à l’origine de la valorisation de l’image de marque de l’entreprise, il convient de s’attacher à mesurer leur proximité par rapport à la culture et aux valeurs de l’entreprise, d’évaluer leurs motivations face à la mobilité interne ainsi que leurs perspectives de carrière au sein de la structure de façon à s’assurer de leur concours dans les turbulences qui sont à l’heure actuelle l’actualité des entreprises.
En effet, de leur participation aux enquêtes, de leur information précise visant les résultats dépendront leur empathie, leur confiance, leur adhésion aux pistes d’actions et aux réflexions visant à améliorer le climat ambiant et, ce faisant, l’image globale de l’entreprise.