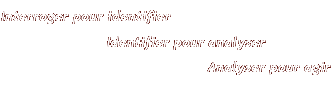Focus groupe et entretien individuel : 2 moyens de recueil des données possédant des vocations distinctes
Souvent la question nous est posée : pourquoi préconisez-vous des entretiens plutôt que des focus groupes ? ou vice et versa. Il est vrai que les 2 méthodes visent à recueillir de l’information. Toutefois, c’est la nature et le contenu de l’information recherchée qui doit inciter à opter pour l’un des 2 moyens :
Le collectif au service de la production d’idées :
L’intérêt du focus réunissant 8 à 10 participants durant 2 à 3 heures réside dans l’interaction dynamique et spontanée des échanges à l’intérieur d’un groupe d’individus ayant les mêmes préoccupations ou des profils proches.
Cette méthode est particulièrement adaptée à la production d’idées dans la mesure où elle permet de balayer un très grand nombre de thèmes de recherche en un temps limité. Elle est de ce fait moins performante lorsqu’il s’agit de valider un concept dont tout ou partie du contenu préexiste.
Les phénomènes de « leader-effect » intragroupe et les mimétismes inter participants peuvent, en effet, limiter l’authenticité de l’introspection individuelle souhaitée : les considérations liées au statut social, à l’image que l’individu souhaite donner de lui-même, à la reprise à son compte d’idées ou de réactions ayant été développées par d’autres participants peuvent masquer, voire parasiter le contenu des informations recueillies.
Si ces facteurs sont sans conséquence lors d’investigations visant à produire des idées créatives, a contrario dans le cadre de l’étude des motivations, le caractère collectif des attitudes peut constituer un handicap dans la mesure où ce dernier occulte les comportements individuels.
D’autre part, sur un plan pratique, le focus groupe n’autorise aucun recul. Dès lors qu’il a été programmé et que l’animateur a débuté la session, il est plus difficile d’en moduler le contenu si cela n’a pas été anticipé.
Toutefois, ce moyen de recueil des données permet à l’ensemble des parties prenantes en charge de l’investigation à savoir les responsables de l’Entreprise et le cabinet d’étude entre autres, de partir d’un état des lieux commun. C’est dans cette intention que vous êtes toujours invité à venir assister en direct au déroulement de ces tables rondes.
L’individuel au service de l’introspection
L’entretien individuel est un moyen d’expression et de recueil d’information qui peut, techniquement, revêtir différentes formes allant du questionnement le plus directif jusqu’à des relances ouvertes induisant des propos spontanés voire des réponses non sollicitées.
Il permet à l’individu de s’exprimer librement dans la mesure où celui-ci, ne serait-ce que physiquement, ne subit pas la présence, voire même la pression psychologique d’autres participants. L’entretien autorise les relances très personnalisées, et cela, à l’instant même où l’interviewé formule sa réponse.
Sur un plan technique la personne interrogée individuellement, ne peut faire état que de ses propres impressions, motivations ou attentes et n’a pas la possibilité de s’inspirer des idées d’autres participants. L’analyse n’en est donc que plus réaliste parce que plus proche du comportement authentique et naturel de l’individu.
Sur un plan pratique, cette méthode est moins réactive, puisque les résultats de l’analyse sont accessibles en différé par rapport au recueil des données.
Toutefois cette modalité permet, en cas de nécessité, de faire évoluer, soit le guide d’entretien, soit le contenu de l’étude, et cela sans attendre la réalisation de l’ensemble des entretiens. Après quelques entretiens, il est toujours possible de prendre des dispositions dans l’optique d’un recentrage en fonction des objectifs poursuivis. Ce moyen permet donc d’optimiser les budgets investis.
En conclusion, il est clair qu’en fonction du contenu des objectifs poursuivis, on optera pour l’un ou l’autre des moyens de recueil, en tenant compte des avantages mais aussi des limites de chacune de ces méthodes qui demeurent complémentaires mais non substitutives.
La traçabilité passera par, la prise en charge des « Traçeurs »…
Les investigations réalisées au stade des cibles industrielles potentiellement visées par la « traçabilité » démontrent que si les équipements répondent en théorie aux cahiers des charges de ceux qui les conçoivent, il convient que ces innovateurs se préoccupent d’inclure ces avancées technologiques au sein d’offres dédiées compatibles avec les applications de leurs destinataires potentiels.
En d’autres termes, actuellement la proposition et la vente de systèmes, aussi performant soient-ils, ne résolvent pas les problématiques de mise en oeuvre engendrées en interne chez les futurs utilisateurs.
En effet, si les Industriels et les Distributeurs comprennent le bien fondé et des apports du « traçage » des supports logistiques, des contenants et de leur contenu, les responsables opérationnels sont confrontés aux problèmes internes induits par ces nouveaux systèmes, dont entre autres :
- Le recrutement de responsables qualifiés susceptibles de prendre en charge ce nouveau département,
- La recherche et l’imputation des financements des investissements relatifs aux équipements dédiés,
- La sélection du partenaire chargé de l’accompagnement en matière de conception des procédures qui rendront compatible cette fonction avec l’activité exercée.
- …
Aujourd’hui encore, selon les industriels et les distributeurs interrogés, peu de prestataires ont la crédibilité ou la légitimité suffisantes pour prendre en charge l’accompagnement « traçabilité », dans la mesure où il leur manque invariablement la «connaissance du métier» de leurs interlocuteurs.
Il est d’ailleurs révélateur que les applications qui fonctionnent aujourd’hui soient le résultat « d’offres packagées » répondant à des applications ponctuelles et offrant des solutions intégrées « clés en main ».
La présence commerciale ne remplacera jamais la proximité de l’installateur .…
Lors d’un audit, réalisé pour le compte d’un industriel commercialisant des équipements à usage domestique, auprès d’un échantillon composé de clients ayant souscrit à l’offre et d’ex-prospects n’ayant pas donné de suite favorable, on a pu vérifier que la relation client privilégie toujours un critère objectif et concret, indépendant de la qualité du contenu de l’offre.
En effet, malgré la mise en place d’un accompagnement technico-commercial visant à instaurer la confiance :
- Une visite faisant suite à la demande de renseignements
- Un diagnostic dédié à partir d’un état des lieux approfondi,
- Un niveau de prescription technique élevé,
- Des références faisant autorité dans la spécialité,
on a pu mettre à jour que le critère de choix ou de distanciation vis à vis de l’offre prenait en compte un facteur externe à l’offre, mais néanmoins déterminant aux yeux des prospects.
Les entretiens rétrospectifs ont fait état d’une perception positive de la démarche tant sur le plan du niveau de contact avec les commerciaux que de la qualité des argumentaires développés. Toutefois lors de l’analyse de contenu des entretiens on a pu mettre en lumière que c’est à l’issue de l’évocation de la localisation du professionnel désigné pour réaliser l’installation, que l’intensité de l’intérêt variait de façon inversement proportionnelle à la distance spatio-temporelle séparant le lieu de l’installation et l’implantation de l’installateur.
Les commerciaux interprétaient le désintérêt des prospects comme émanant d’un manque de maturité du projet voire de moyens financiers insuffisants. L’analyse a permis d’identifier que l’évaluation de la proximité ou l’éloignement géographique de l’installateur retenu était en fait déterminante. Lorsque l’installateur se situait au-delà de 50 km ou de 30 minutes en voiture, le niveau d’intérêt régressait notablement.
Une écoute attentive a ainsi pu éviter la remise en question de la sélection des prospects ou le remaniement de l’offre. En effet, la recommandation s’imposait d’elle-même : recruter des installateurs.
Effets collatéraux des RTT sur nos animaux de compagnie
Au cours d’un sondage visant un nouveau concept de nutrition destiné aux animaux de compagnie, réalisé pour le compte d’un fabricant de pet-foods, une nouvelle tendance directement issue de l’évolution des modes de vie des Français a pu être identifiée.
Un nombre conséquent de possesseurs de chiens ayant déclaré avoir du se séparer de leur compagnon à quatre pattes ou, plus surprenant encore, avoir remplacé ce dernier par un nouveau compagnon de race féline, nous nous sommes intéressés à cette mutation de comportement susceptible de faire évoluer le marché.
Dans plus de 50% des cas, nos interlocuteurs ont justifié leurs nouveaux choix de compagnons en invoquant les transformations régissant l’emploi de leur « temps libre », directement induites par la semaine de 35 heures, les RTT, voire les préretraites de plus en plus précoces.
En effet, l’accroissement du temps libre suscite l’envie de « bouger » et la multiplicité des déplacements en particulier des voyages de courte durée apparaissent de plus en plus difficilement compatibles avec la possession d’un chien dont la dépendance au quotidien s’accomode mal de ces absences récurrentes.
En contrepartie, selon ces mêmes interlocuteurs, l’indépendance du chat dans sa vie domestique, et la possibilité de laisser cet animal, seul au foyer, durant quelques jours en font le compagnon idéal, tout à fait adapté à ce nouveau style de vie.
L’identification de ce phénomène illustre parfaitement les apports d’une étude fondée sur des entretiens en profondeur. En effet, un test purement technique peut, comme ici, déboucher sur la mise à jour de considérations sociologiques plus fondamentales puisque relatives au mode de vie des Français.
Les motivations d’achat privilégient aujourd’hui la raison plutôt que la passion…
Les dernières investigations conduites dans les secteurs des produits domestiques démontrent que, face à la consommation, les individus gardent plus que jamais les pieds sur terre.
Oscillant entre passion et raison, les comportements observés traduisent une stratégie d’achat de plus en plus réfléchie, induite par le sentiment de vivre des moments plus difficiles, plus incertains, qu’au cours des dernières décennies.
Si la recherche de la dimension plaisir ou confort apparaît toujours présente, la démarche d’achat est désormais conduite au sein d’un cadre rationalisé. On assiste en effet, aujourd’hui de plus en plus à des arbitrages où la recherche de compromis objectifs arrive dans le peloton de tête des comportements de consommation.
Un exemple illustre ces évolutions actuelles, il s’agit des attitudes observées à l’égard des énergies renouvelables en matière de chauffage, qui demeure la principale source de dépense énergétique domestique : La majorité des individus ayant fait construire une maison auraient souhaité avoir recours à des systèmes fonctionnant au moyen de ces énergies « gratuites » (soleil, air, eau …) tant pour le confort et l’économie à l’utilisation, que pour la protection de l’environnement induit.
Toutefois, au final seule une minorité d’installations relèvent de ce choix s’inscrivant pourtant dans un développement durable. En effet, les motivations qualitatives et environnementales cèdent le pas à des critères financiers immédiats : l’investissement initial élevé impliqué par ce type d’installations.
A l’heure actuelle le consommateur va à l’essentiel, voire à l’existentiel. Il développe de fortes préoccupations sécuritaires qui mettent en avant des produits affichant des rapports qualité/prix optimisés. L’effet nouveauté jouant un rôle relativement secondaire.