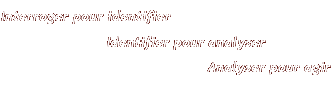Né fixe, devenu mobile, bientôt terminal universel, le téléphone devient une réelle extension de soi…
Lors d’un test concernant une nouvelle application dans le cadre des paiements électroniques sans contact, on a pu observer qu’un nombre conséquent d’individus projettent ces transactions comme devant idéalement devenir une nouvelle fonction assumée par l’organe désormais greffé à l’extrémité de leur membre supérieur : leur mobile.
Après la photo, la musique, la radio, les jeux, la vidéo, ce support, point de convergence de toutes les dernières technologies numériques, étendrait ainsi encore son champ d’action.
Le recours au mobile simplifierait les paiements dans les mêmes conditions qu’un paiement par carte bancaire. Il offrirait les qualités premières qu’on associe spontanément à ce support :
- La simplicité : la possession d’argent liquide n’est plus indispensable,
- La rapidité : l’absence de monnaie à échanger ou de chèque à compléter fluidifie le passage en caisse,
- La sécurité : l’objet multifonction, élevé au rang d’accessoire omniprésent le prémuni des oublis.
Toujours à portée de main, il devient une véritable extension de soi. Le fait qu’il intègre des données et des applications variées accroît symboliquement l’emprise que les individus souhaitent avoir sur leur environnement.
Ces attentes formalisées par les individus interrogés, prouvent que le mobile est sur le point de devenir un véritable terminal universel qui se mue en passerelle d’accès à l’ensemble des nouveaux services numériques dans les domaines du commerce, des transports, des loisirs, et d’autres bouquets de services numériques qui, sait-on jamais, finiront peut-être un jour par permettre au mobile d’intégrer les fonctions de l’ordinateur.
En effet, la convivialité de ce support, née d’une utilisation « intuitive », ne nécessite pas l’apprentissage qu’implique la maîtrise d’un ordinateur.
A-t-on vraiment intérêt à spécifier le caractère résolument nouveau d’un produit …
Lors d’une récente étude visant un concept innovant situé dans le domaine grand public, on a pu observer que lorsque l’utilisateur potentiel qualifie spontanément celui-ci de « produit nouveau », en fait cette appréciation peut aussi sous-tendre une distanciation psychologique face à l’innovation.
Au cours de cette investigation qualitative, les individus interrogés ont unanimement perçu et exprimé les fonctionnalités nouvelles permises par la technologie, toutefois face à cette innovation deux types d’attitudes ont pu être identifiées :
Des comportements clairs émanant d’individus transposant immédiatement les applications issues des avancées techniques dans leur vie de tous les jours. Ces derniers considèrent explicitement le concept comme une évolution logique du produit actuel. Leurs intentions d’achat se concrétisent par l’évocation de prix psychologiques confirmant le bénéfice immédiat induit par le produit intégré dans un continuum sécurisant.
Des réactions ambiguës émanent d’individus qui associent le progrès technologique ayant présidé à la création du concept à un produit en rupture avec l’actuel. En effet, si ces derniers font état des nouvelles possibilités induites, ils demeurent prudents quant à la réelle nécessité d’une substitution du produit existant par le futur. Les intentions d’achat sont ici moins concrètes : le produit devra passer par une phase d’observation durant laquelle ils ne souhaiteront pas s’acquitter du surcoût inhérent à la novation. Celle-ci devra démontrer le bien-fondé de ses avancées.
Cette dichotomie ne serait pas un frein au développement du produit si la proportion ne penchait pas nettement en faveur de la 2° population qui représente plus de 70% des individus.
Le fait de mettre l’accent sur la novation peut différer la pénétration d’un produit en lui imposant une période de « purgatoire » qu’il n’aurait peut-être pas connu si on avait laissé, à chaque utilisateur potentiel, le soin d’en apprécier l’importance.
La Réversibilité est à l’origine du profond changement de statut de la clim’ en France
La dernière étude nationale réalisée dans l’univers de la climatisation domestique destinée aux particuliers a permis de constater qu’en l’espace de 5 ans un énorme pas avait été franchi !
En effet, depuis de longues années, l’image de la climatisation résidentielle restait désespérément connotée à un « concept de luxe » résolument destiné aux somptueuses villas situées sur les hauteurs du pourtour méditerranéen, selon la grande majorité des français interviewés.
Certes, la climatisation automobile avait permis de prendre conscience des apports bénéfiques de son rôle anti-stress dans la circulation et avait quelque peu entamée l’image traditionnellement associée aux « happy few ». Mais c’est la conjonction de différents facteurs, dont certains non programmés, qui ont engendré la rapide évolution de perception du concept. Il s’agit en fait :
D’une part, des progrès technologiques de la thermodynamique et en particulier la réversibilité de la pompe à chaleur permettant, à partir des mêmes échangeurs, la fonction chauffage. Cette nouvelle dimension ayant définitivement gommé la « connotation luxe » de l’installation au profit d’une « image utilitariste », à l’instar des autres types de chauffages classiques.
D’autre part, le réchauffement climatique et ses aléas ont fait prendre conscience que le mode rafraîchissement autorisait des températures permettant de continuer à vivre normalement voire confortablement en période caniculaire. Ce confort devenant salutaire voire vital lorsque l’âge ou l’état de santé précaire vulnérabilise l’individu.
Le développement exponentiel des ventes de ces nouveaux systèmes confirme, s’il en était besoin, le profond changement de statut d’une technologie, qui hier encore ne répondait pas aux motivations profondes des Français qui prétendaient « vivre au rythme des saisons »…
Attention à ne pas confondre la « cerise et le gâteau », ou un facteur déclenchant et une motivation de base …
Lors de 2 investigations conduites dans des secteurs où les investisseurs, appartenant au domaine grand public, bénéficient d’incitations fiscales sous la forme de crédits d’impôts, on a pu observer que les professionnels valorisent ou dramatisent la place tenue par ce type de mesures gouvernementales.
En effet, selon ces professionnels, le bonus fiscal constitue une motivation d’achat à part entière dont ils font état dans leurs argumentaires de vente. Ces derniers l’évoquent invariablement dans les premières places de la hiérarchie des stimuli ayant conduit à l’acte d’achat.
En revanche, lorsque l’on interroge les prospects en phase de réflexion précédant la prise de décision d’achat, on note que cette incitation d’ordre fiscal ne figure jamais au sein des critères entrant dans le choix du produit. Ces derniers évoquent, soit des motivations ayant trait aux bénéfices inhérents au produit lui-même, à ses apports qualitatifs, soit des freins du même ordre.
Ce n’est que lorsqu’on interroge les clients, c’est-à-dire les prospects ayant réalisé l’acte d’achat, que ces derniers font référence au crédit d’impôt. Les propos énoncés permettent de comprendre la fonction remplie par le bonus fiscal qui n’intervient qu’en phase terminale d’une réflexion à l’issue d’une période d’hésitation, de gestation plus ou moins longue.
En fait l’incitation fiscale a été le « facteur déclenchant », le « catalyseur d’achat », voire la « cerise sur le gâteau », mais n’a, pour ainsi dire, jamais permis de se déterminer en faveur de l’achat du produit.
Avant d’en faire état, les professionnels doivent donc identifier la position du prospect au sein de sa démarche : Si ce dernier est parvenu dans la phase finale, le crédit d’impôt jouera un rôle de déclencheur de prise de décision. Dans le cas où le prospect se situe dans la phase initiale de sa recherche, l’argument risquera d’être improductif et pourra même discréditer celui qui en fait état, puisqu’il n’entre pas dans le spectre des motivations d’achat de base.
Mesurer le niveau d’insatisfaction c’est bien, en supprimer les causes c’est encore mieux…
Les résultats issus de l’avant dernière vague d’un baromètre social interne, réalisé au moyen de questionnaires en ligne, avaient permis de collationner les réponses de plusieurs centaines de collaborateurs.
L’analyse des mesures portant sur un large référentiel de critères a permis de localiser les foyers d’insatisfaction en termes de profils, de collège d’appartenance, d’âges, de sexes, et de hiérarchiser les axes de préoccupations. Ces préoccupations se traduisant par des notes négatives concernant des rubriques mettant en cause l’information et la communication interne ….
Le baromètre aurait pu en rester là si nous n’avions pas pris initialement la précaution de prévoir une phase qualitative destinée à affiner les résultats quantifiés.
Au cours de cette seconde phase les entretiens individuels administrés auprès d’un échantillon de quelques dizaines de collaborateurs correspondant aux « profils d’insatisfaits » ont permis d’une part de mettre à jour la véritable cause profonde pénalisant le climat social et d’autre part de définir les moyens permettant à la DRH d’inverser la tendance.
En résumé, il a été possible d’identifier que la baisse du niveau de satisfaction émanait en particulier de jeunes cadres ayant fait partie d’une importante vague d’embauche récente, inquiets quant à leur devenir dans une entreprise en profonde restructuration. Ces derniers n’avaient pas trouvé d’autres solutions, pour traduire leur manque de visibilité, que la remise en cause des moyens d’information interne.
On a donc pu prendre des dispositions spécifiques destinées à rassurer cette typologie de collaborateurs à l’aide d’actions ciblées et personnalisées concernant leurs perspectives d’évolution interne.
La dernière vague du baromètre social a permis de constater que les niveaux de satisfaction sur les critères incriminés ont retrouvé un profil satisfaisant, confirmant ainsi la complémentarité des deux types de mesures.