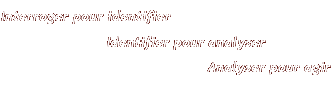Aujourd’hui on ne rougit plus d’avouer qu’on est Économe …
Lors d’une récente étude visant un système fonctionnant à l’aide d’une énergie renouvelable on a pu observer une modification du comportement des consommateurs à l’égard de la « réalisation d’économies ».
Au sein de cette investigation qualitative, les individus interrogés ont unanimement fait part, à un moment ou à un autre des entretiens, de leur volonté fondamentale de réaliser des économies d’énergie, de se distancier d’énergies fossiles affichant des tarifs en perpétuelle hausse, en un mot de « faire des économies » au sens large.
Lorsque l’on compare ces attitudes avec celles qui ont été analysées il y a maintenant 15 ans auprès des automobilistes ayant opté pour une motorisation diesel, on mesure le chemin parcouru. En effet, à l’époque ces derniers n’osaient pas avouer qu’ils avaient fait ce choix par mesure d’économie craignant d’affecter leur image aux yeux de leur entourage. Ils s’efforçaient de masquer leur motivation profonde à l’aide d’alibis divers, tel un comportement citoyen privilégiant un moteur moins polluant ou encore une attirance pour l’innovation technique…
Les propos de l’ensemble de la classe politique relayés par les médias et les locomotives de la société civile, concernant la recherche d’économies d’énergie, ont profondément fait évoluer le statut ou l’image de celui ou de celle qui adopte un comportement « économe ».
Faire des économies est devenu politiquement correct, voire valorisant pour celui qui fait état d’une telle démarche. À tel point que c’est l’adoption d’une attitude n’obéissant pas à cette nouvelle norme qui aujourd’hui peut passer pour marginale.
On n’a donc plus à rougir d’avouer ou d’adopter un comportement Économe. Il est aussi vrai que depuis longtemps déjà, on avait appris à tout « gérer » (même ses émotions !).
Cette nouvelle tendance lourde n’a cependant pas encore été exploitée sur le mode majeur et les story-boards publicitaires traitent toujours ce thème de façon humoristique, voire décalée.
Les supports interactifs au service de la relation client valorisent le rôle des commerciaux sur le terrain
Lors d’un audit commercial visant l’équipe de vente d’une grande marque commercialisant des PGC, il a été possible de mesurer les bénéfices induits par l’usage des supports d’information interactifs dans le domaine de la relation client.
En effet, hier il était fréquent de visiter un client sans connaître l’état de ses dernières commandes dès lors que la tournée n’avait pas été précédée d’une soigneuse préparation. Aujourd’hui une telle situation n’existe plus dans la mesure où la force de vente est équipée de téléphones mobiles, de PDA, de GPS, ou d’ordinateurs portables susceptibles de la relier en permanence à son entreprise et de la connecter aux systèmes d’informations internes.
La possibilité de disposer à tout moment d’informations sur le client (dernières commandes ou livraisons, habitudes d’achats…) de consulter ou de renseigner les bases de données de l’entreprise depuis le lieu de rendez-vous renvoient au client visité une image de modernité et de dynamisme qui bénéficie à la fois au collaborateur sur le terrain et à l’entreprise.
Sur un plan économique, cette génération de supports mobiles permet simultanément de minimiser les déplacements, les coûts de transport et de maximiser les temps de visites ou d’interventions en clientèle.
Enfin grâce à ces médias, la possibilité de faire transiter rapidement les flux d’informations des centres de décision aux utilisateurs mobiles et inversement du terrain au management de l’entreprise valorise les partenaires en relation avec les clients.
L’heure est à la mobilité et à la polyvalence, la plupart des responsables sont en mesure d’effectuer un grand nombre de tâches commerciales et de traiter n’importe quel problème administratif à distance. Le temps ainsi gagné est à inscrire au crédit de la relation client.
Le plaisir de manger serait-il la meilleure parade face à l’obésité
En marge d’un sondage réalisé auprès de convives dans l’univers de la restauration, on a pu mettre à jour un certain nombre de comportements pouvant faire échec au surpoids, voire à l’obésité auxquels est potentiellement exposé un nombre croissant d’individus.
Lorsque l’on analyse les réponses, selon que les personnes interrogées se situent en surcharge pondérale ou non, on observe qu’à CSP identiques, les profils se situant dans la norme sont plus sensibles au plaisir de bien manger qu’au contrôle des quantités et au volume des portions ingérées, qui sont valorisées par les individus en surpoids.
Les temps moyens de prise de repas déclarés démontrent qu’à menus identiques les individus en surcharge consacrent pratiquement deux fois moins de temps pour se restaurer que les individus se situant dans la moyenne pondérale. Corrélativement à cette observation, plus les individus s’alimentent de façon collective et moins ils ont tendance au surpoids, ce qui confirme que la manière dont on consomme, et en particulier que la convivialité, s’avère être un remède contre la prise de poids qui guette les solitaires considérant la nutrition comme une préoccupation individuelle.
Paradoxalement on constate que les individus qui déclarent consommer une cuisine plus riche ou boire plus de vin ne sont pas les plus exposés à l’obésité. Il émane, en effet, des entretiens que le fait de se restaurer, pour les individus se situant dans la norme pondérale, fasse partie d’un ensemble où l’acte de manger est relativisé, étant aussi le prétexte à se réunir, à apprécier ce moment privilégié, à commenter l’aliment consommé ….
A contrario, les candidats à l’obésité considèrent la fonction alimentaire comme étant la préoccupation première, privilégiant les notions quantitatives et nutritives au détriment de la dimension qualitative de l’instant.
En fait, on peut en conclure que plus l’alimentation entre dans un registre culturel et moins l’anxiété génératrice de surpoids, n’a de prise voire de conséquences physiologiques négatives.
Sa raréfaction et son renchérissement sont à l’origine de nouvelles attitudes à l’égard de l’usage de l’eau
Lors d’un récent sondage visant des mobiliers sanitaires, on a pu constater que la perception et le statut de la salle de bain évoluaient en sens inverse de l’usage et de l’image de l’eau.
Si hier ce local souvent désuet, dédié à une hygiène sommaire et rapide, constituait le parent pauvre de la maison, aujourd’hui plus des deux tiers des occupants interrogés souhaitent transformer ce lieu en une pièce à vivre reflétant leur propre image et objectivant leur style de vie.
On enregistre à ce propos des sources d’inspiration diversifiées dela part des intéressés. Ces derniers évoquent la recherche de styles, selon les cas, rétro, contemporain, avant-gardiste, exotique, rustique, minimaliste, design …. dont doivent dorénavant tenir compte les sanitaires, les mobiliers dédiés et les équipements coexistant dans cet univers voué à la valorisation de l’eau reconnue comme étant synonyme de détente, de bien-être.
Cette évolution est corroborée par l’allongement des temps passés dans ces lieux de plaisir hédoniste, qu’on assumait difficilement lorsque leur vocation n’était que fonctionnelle : On évoque désormais des séjours quotidiens se situant en moyenne entre 40 et 50 minutes, selon les sexes. Soit des durées supérieures de 50% par rapport à celles qui étaient avouées, il y a seulement une dizaine d’années.
A l’heure du réchauffement climatique, où les équipements de balnéo ou d’hydrothérapie font partie des réponses aux attentes implicites ou explicites des individus envisageant la rénovation de leurs salles d’eau, qu’une culpabilisation récurrente se fait jour chez un certain nombre d’entre eux : On parle de raréfaction et simultanément de renchérissement du prix de l’eau, est-il alors écologiquement correct d’en accroître la consommation ? ….
On décèle ici la perspective d’un nouveau paradoxe : En effet, à l’heure où la salle de bain devient la préoccupation du plus grand nombre, c’est l’usage de l’eau qui est en passe de devenir un luxe …
Progrès techniques et évolution socio-démographique favorisent la délégation de services
Les dernières études réalisées tant au niveau des particuliers dans le cadre des « services à la personne », qu’au stade des entreprises dans le cadre de « l’externalisation des services » font état de résultats convergents dont les similitudes peuvent expliquer les pénétrations lentes mais continues au sein des deux univers.
Deux des freins fréquemment mis en avant font référence, d’une part à la réticence à déléguer des tâches relatives à l’intimité du foyer, ou pouvant porter atteinte au secret de fabrication de l’entreprise et d’autre part à la crainte d’avoir à faire face à un déficit de spécialisation voire même de professionnalisation de la part des intervenants proposant leurs services.
Dans les deux filières, ces freins psychologiques ou culturels énoncés par les interviewés ne sont pas radicalement éloignés les uns des autres, mais ce phénomène ne doit pas surprendre si l’on considère qu’une entreprise est, en fait, la somme d’individualités régies par des motivations profondes ayant logiquement des racines communes.
Le futur, envisagé par les interviewés, permet toutefois de prévoir un avenir favorable à la délégation de services. En effet, dans la mesure où les facteurs socio-démographiques et les progrès technologiques ne permettront plus aux particuliers de faire face aux nécessités du quotidien et que les entreprises n’auront plus les ressources humaines et économiques suffisantes pour maîtriser en interne des services ou des process requérant des connaissances de plus en plus diversifiées, le recours aux « services à la personne » ou à « l’externalisation des utilités » s’imposera inexorablement.
Toutefois les récentes vicissitudes rencontrées dans le domaine de l’aéronautique constituent une sérieuse mise en garde. La délégation implique, en effet, un contrôle accru des compétences et de la qualité des prestations des intervenants extérieurs. La décision ne doit pas résulter de la seule recherche d’optimisation des coûts car cette quête trouve vite ses limites.